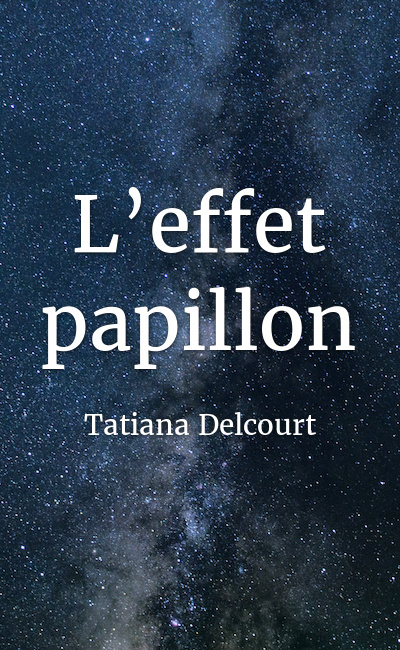Lors d’un stage d’été à la fac, j’ai assisté à une conférence imprévue animée par un astrophysicien invité. Je ne le connaissais pas ; ce n’était même pas la raison principale de ma venue ce jour-là. Son intervention était courte, presque une parenthèse dans le programme, devant une poignée d’étudiants vaguement curieux.
Il a parlé du “modèle de la poussière d’étoile” : cette idée que nous sommes toutes constituées d’éléments venus d’astres morts il y a des milliards d’années. Mais il l’a évoquée non pas comme une formule physique, mais comme une source de poésie, une invitation à la modestie et à l’émerveillement quotidien.
En sortant de la salle, je me suis sentie soudain minuscule et immensément riche à la fois. Cette idée m’a accompagnée longtemps : elle a relativisé mes angoisses, aiguisé ma curiosité, m’a permis de regarder les autres et moi-même avec un mélange d’humilité et de tendresse. Je n’ai jamais revu ce chercheur, j’ai oublié son nom, mais ses mots planent encore sur mes journées.
Sans le savoir, il a changé ma façon de regarder le monde : tout, désormais, me semblait moins figé, plus mystérieux, plus précieux. À ce fragment de voix croisé une seule fois, je resterai secrètement reconnaissante d’avoir semé une petite étincelle de vertige et de beauté dans ma vie ordinaire.
 Tatiana Delcourt
Tatiana Delcourt